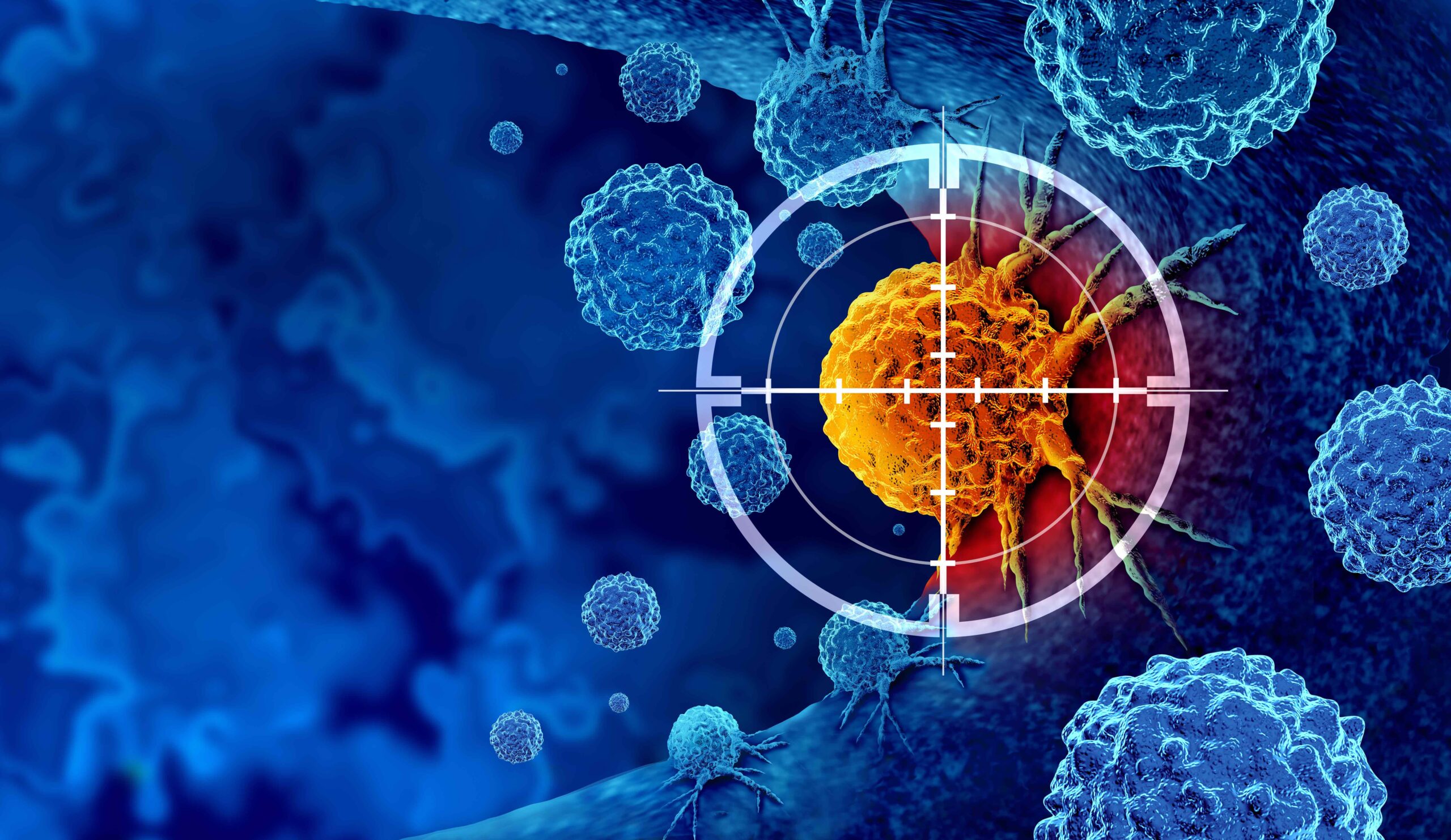La technique REZUM, utilisant la thermothérapie par vapeur d’eau, est une méthode très peu invasive qui vise à réduire le volume de la prostate en injectant de la vapeur directement dans le tissu prostatique qui s’est hypertrophié avec le temps et l’âge des patients.
Cette vapeur, à environ 103°C, provoque une nécrose thermique des cellules, ce qui entraîne leur destruction et finalement une réduction du volume prostatique.
Procédure et Efficacité
La procédure REZUM se réalise en ambulatoire (entrée et sortie le jour-même), sous une anesthésie générale légère (sédation).
Un cystoscope est inséré dans l’urètre, permettant d’accéder à la partie interne de la prostate.
Des injections de vapeur de 9 secondes sont administrées dans les zones ciblées, avec une moyenne de 4 à 10 injections par intervention (cela dépend du volume à traiter, de l’anatomie et de la forme de la prostate).
La procédure complète dure approximativement de 15 à 20 minutes.
Post-intervention :
Il est nécessaire de garder une sonde urinaire pendant une semaine pour assurer un drainage adéquat de la vessie et prévenir la rétention urinaire, car la prostate « gonfle » au début (risque de blocage urinaire en l’absence de sonde). La sonde permet également de minimiser l’irritation urinaire durant la phase de récupération initiale. Elle sera retirée après une semaine et la reprise des mictions sera surveillée.
Avantages clés
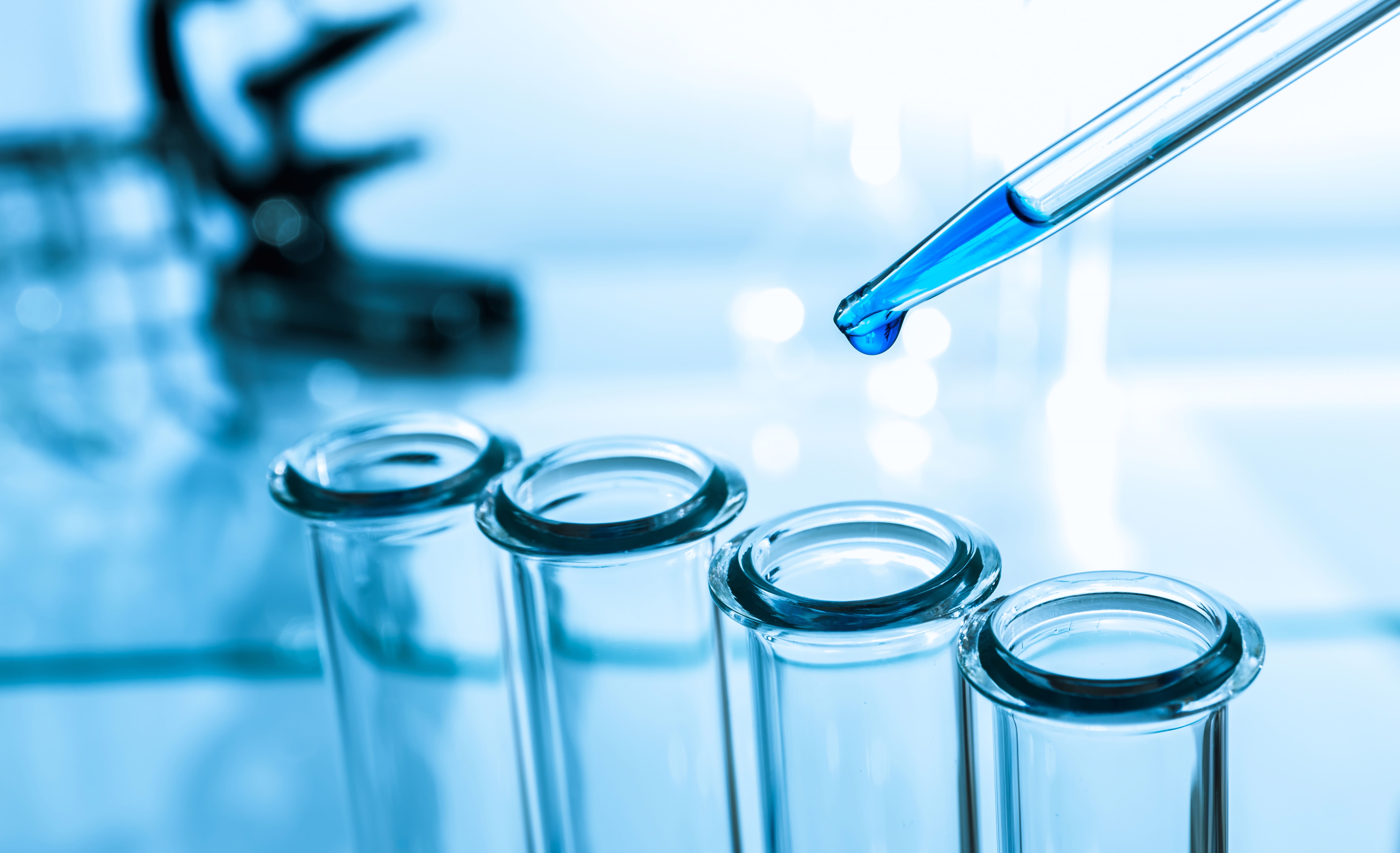
- Préservation de la Fonction Éjaculatoire : Contrairement à d’autres traitements de l’HBP, tels que la résection trans-urétrale de la prostate (RTUP), la technique REZUM présente un risque minimal d’effets secondaires sexuels, y compris les problèmes d’éjaculation rétrograde. Cette préservation est un bénéfice significatif pour les patients soucieux de maintenir leur fonction sexuelle post-traitement.
- Récupération Rapide et Moins Invasive : Le caractère minimalement invasif de REZUM permet une récupération plus rapide que les interventions chirurgicales traditionnelles. Les patients peuvent généralement reprendre leurs activités normales en quelques jours, avec des améliorations des symptômes urinaires observées dès 2 à 6 semaines.
- Durabilité des Résultats : Les études cliniques indiquent que les effets bénéfiques de REZUM, tels que la réduction des symptômes urinaires et l’amélioration du débit urinaire, peuvent durer plusieurs années. Cette durabilité fait de REZUM une option attractive pour les patients à la recherche de solutions à long terme leur permettant également de ne plus prendre de médicaments (alpha-bloquants ou autres).
Conclusion

La technique REZUM représente un avantage certain dans le traitement de l’HBP grâce à son approche innovante utilisant la vapeur d’eau. Elle offre une alternative efficace et sûre aux méthodes plus invasives, avec des gains notables en termes de préservation de la fonction éjaculatoire et de récupération rapide.
Évidemment, seule la consultation d’urologie et le bilan global préopératoire permettront de confirmer que la technique REZUM est adaptée pour un patient donné.